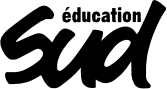Avec 280 millions de m², les établissements scolaires représentent 30% de la consommation en énergie des bâtiments communaux. Face à cette réalité, le conseil régional et départemental multiplient les déclarations d'intention à travers des plans d'action et tentent de convaincre l'opinion de la sincérité de leur engagement dans l'écoconstruction.
Le département de Seine-Saint-Denis a, par exemple, lancé un Plan d'action pour la transition écologique entre 2017 et 2020 avec le projet de végétaliser les espaces extérieurs des crèches, de baisser de 20% la consommation énergétique, de végétaliser les toitures, du réemploi de mobilier avec une plateforme de dons et de revente aux associations et aux particuliers de son mobilier et petit équipement usagé... Quel est donc le bilan de ce plan ? Qu'a-t-on vu concrètement dans nos établissements ? Soyons francs : pas grand chose.
Il existe pourtant un concept : la HQE « Haute Qualité Environnementale » apparue en France dans les années 90 et qui vise à intégrer dans le bâtiment les principes du développement durable qui doivent s'appliquer lors de la construction, du fonctionnement et de la déconstruction.
L’organisme qui détient la licence exclusive HQE pour la France se nomme l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). Une étude a été faite dans l’Hérault qui montre que la consommation énergétique d'un collège HQE est inférieure de 12 à 34% à celle d'un collège classique.
Cette organisme a publié en 2015 une étude qui vise à produire de l'énergie à 100% renouvelable pour 2050 en partant de plusieurs scénarios. Par exemple, l'un serait : 63% d'éolienne, 17% de solaire, 13% d'hydraulique, 7% de géothermique et de thermique renouvelable. Le mégawattheure ne coûterait que 2 euros de plus que dans le scénario envisagé par la loi de transition énergétique.
Ce rapport qui aurait dû sortir au moment où la loi sur la transition écologique passait au vote à l'Assemblée a été ajourné. Il nous faut préciser que l'ADEME est sous tutelle du préfet…
Alors comment les établissements scolaires peuvent-ils intégrer ces normes ? Et comment pouvons-nous œuvrer afin que cela puisse se faire dans des délais plus courts ?
Il nous faut d’abord examiner la question de l’énergie que peuvent produire les établissements pour leur propre consommation : Les panneaux solaires sont une réponse à condition de pouvoir utiliser des composants recyclables, la géothermie est une autre piste à envisager mais rien ne semble à l'ordre du jour de ce côté-là alors même que les surfaces sur les toits et au sol sont importantes…
Il ne faut pas oublier que tout ceci dépend également et surtout d'une meilleure maîtrise de la consommation en énergie. Cela passe bien sûr par une meilleure isolation de l'ensemble des bâtiments qui doit faire suite à un diagnostic précis communiqué aux conseils d'administration des établissements. Il y a de nombreuses autres solutions à notre portée : l'utilisation d'éclairage à basse consommation, les toits végétalisés, des éclairages gérés par une centrale technique en fonction de la lumière extérieure, une gestion de l'eau avec une récupération des eaux fluviales pour les WC et l'arrosage...
Les épisodes de fortes chaleurs deviennent presque banals en ville, où les phénomènes de canicule sont de plus en plus nombreux. Les cours de récréations sont des îlots de chaleur urbaine (ICU) car bétonnées et bitumées et qui avec leur matériaux minéraux absorbent et retiennent la lumière du Soleil. On pourrait donc réaménager ces lieux, les végétaliser et les rendre accessibles en dehors du temps scolaire à la population.
Il y a urgence à appliquer ces normes écodurables. Le parc immobilier ne peut attendre d'être renouvelé dans sa totalité ou que les établissements tombent en décrépitude.
La région a bien sûr les moyens financiers de mettre en œuvre ces aménagements si cela devenait une priorité. Le département lui, comme trop souvent, on va arguer du manque de moyen pour ne pas agir. Il ne s'agit en vérité que d'une volonté politique qui, détachée des échéances électorales, permettrait un investissement à long terme pour les élèves d’aujourd’hui et de demain.
Quelques expériences ont bien sûr déjà eu lieu :
- Le premier édifice public isolé en paille est une école d'Issy-Les-Moulineaux dans les Hauts de Seine.
- La première ayant des murs porteurs en paille est à Rosny-sous-Bois en Seine Saint-Denis.
- Le premier lycée ayant une démarche environnementale globale est à Calais.
- Le premier lycée en ventilation naturelle se trouve à Montpellier.
Sur Paris, il est prévu que d'ici 2030 toutes les cours seront réaménagées, végétalisées pour faire de l'ombre, avec des revêtements innovants qui retiennent l'eau et deviendront accessibles à la population dans le cadre d'un Plan Climat Paris.
Qu'en sera-t-il des cours de récréation dans les établissements du 93 ?
Témoignages de personnels – un chantier de lycée mal pensé, une école écologique
« J'ai travaillé deux ans à l'école des Boutours de Rosny. A cette époque, le bâtiment comportant un étage abritait une maternelle. Les murs constitués de briques agglomérées de Terre et de paille nous ont protégés efficacement et naturellement contre les chaleurs de l'été. Le toit végétalisé nous a permis d'aller deux fois l’an cueillir des framboises avec les enfants (bien que la structure toute en longueur du bâtiment ne soit pas bien pratique pour des maters). La ventilation naturelle se faisait via des conduits qui prenaient beaucoup de place dans les salles de classe que tous les instits jugeaient trop petites.... »
« Le lycée Mozart au Blanc Mesnil après des années de lutte et de blocages est en rénovation. Les travaux ne sont pas totalement terminés. Ils ne changent pas le système de chauffage dont la conception est défectueuse. Pour l'isolation, on ne saurait encore dire si elle sera bonne. Par contre, une partie des fenêtres et les rideaux livrés en octobre sont déjà cassés. Ils nous rajoutent une toiture végétalisées non prévue au départ dont nous avons bien peur qu 'elle soit ponctionnée sur le budget isolation et étanchéité… »
Nous revendiquons :
- le développement de la production d’énergie renouvelable sur site (panneaux solaires…)
- la systématisation des diagnostiques énergétiques
des bâtiments dont les résultats doivent être communiqués aux usagers et personnels
- la maîtrise des consommations : isolation de l'ensemble des bâtiments, mise en place d'éclairage à basse consommation et « intelligents », toits végétalisés, ventilation naturelle, récupération des eaux fluviales...
- la végétalisation des cours de récréation qui doivent être accessibles en dehors du temps scolaire à la population en cas de fortes chaleurs